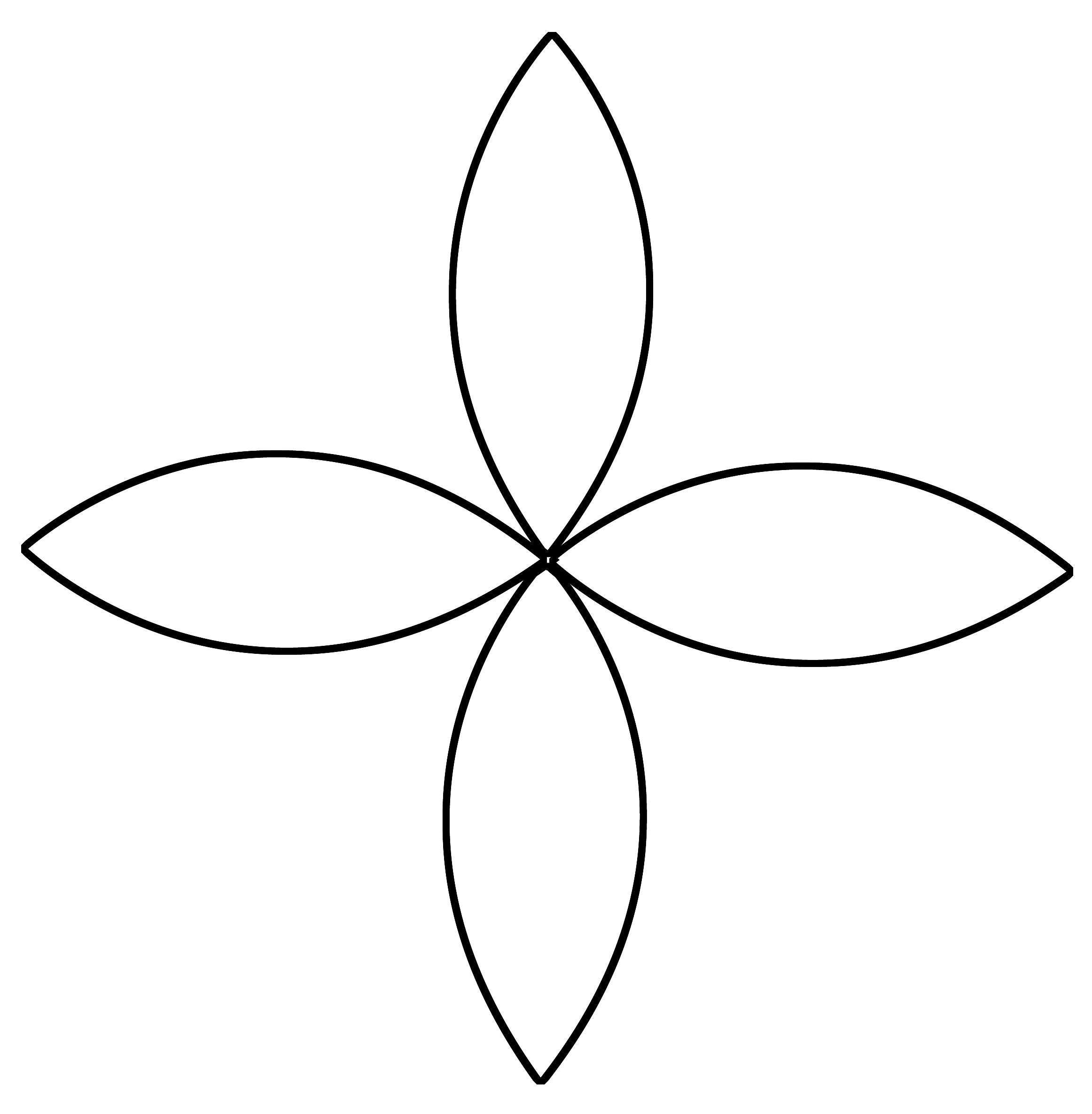La recherche : En conclusion
Utilisation des sources
Du béjaune au bleu
Horizon des recherches existantes
Esthétique des rituels étudiants
Rites étudiants - Délire ou Magie primitive?
Esthétique de la souillure
En conclusion
Analyse du film "Praxis"
Le voyage que nous avons réalisé ensemble nous permet à présent de faire la synthèse de ce que sont les rites étudiants. Tout d’abord, il faut remonter loin dans le passé, à une époque où l’apprentissage des connaissances se faisait par le biais du culte.
Depuis la nuit des temps, le mythe symbolisé par la grande déesse préfigure toutes les religions qui l’ont suivie. Rien n’existait auparavant, si ce n’est l’art, qui permit l’éclosion du langage et de la magie, et se nourrissait d’eux. L’apparition et la diffusion des mythes est un acte créateur, et par voie de conséquences, artistique.
Inanna, du mythe babylonien, fut mariée à un humain. Celui-ci profita du voyage de son épouse partie visiter sa sœur qui régnait aux enfers pour subtiliser le trône de son épouse. L’intérêt de ce mythe primordial montre que même une déesse ne descend pas impunément aux enfers, où elle devra rester, sauf si elle envoie un autre dieu à sa place – qui s’avèrera être son mari, divinisé par son mariage à la déesse. Le mythe ne possède pas une retranscription complète, mais au final, mari et femme se succèderont sur le trône par tranches de six mois. C’est le principe de vie/mort/vie par excellence, la plante vit, meure, renaît de sa graine.
De ce principe de vie/mort/vie découleront tous les cultes à mystère. Ceux-ci proliférèrent par les mythes agraires d’Inanna, d’Astarté, Ishtar, Isis, Dionysos le dieu masculin travesti, …
Pour en arriver là, il faut quitter les cultes d’agriculteurs et passer au culte monothéiste judaïque, typique des cultes d’élevage. Le dieu unique prend une place considérable, il est vindicatif et jaloux. On ne peut pas l’honorer et prier d’autres cultes en même temps. La masculinisation du mythe agraire est intéressante à plusieurs points de vue, puisque tout part d’Egypte et d’Osiris le démembré ramené périodiquement à la vie. Dionysos, est souvent perçu comme héritier d’Osiris. Il est un demi-dieu doux et bon, mais dont les cadeaux ont le désavantage de mal tourner s’ils ne sont pas maîtrisés. Il est le patron de la vigne et du vin, de l’ivresse, de l’aspect sauvage car il préside aux fauves – ce qui lui donne une autorité égale sur les agriculteurs et sur les éleveurs, il fut tué trois fois et est revenu chaque fois à la vie. C’est un dieu des limites.
Tous ces aspects firent de lui un précurseur de la figure de Jésus. L’église naissante ne s’y est pas trompée et a intégré la plupart des aspects dionysiens dans la figure du Christ et de son culte.
Lors des invasions barbares sur l’empire romain, le savoir se dissémina chez les érudits et dans les monastères. Sous Charlemagne, Alcuin fit un travail de titan pour réunir à nouveau ce savoir, et le multiplier. Il fallut trois siècles pour qu’arrivent enfin la reconnaissance des centres d’enseignement, et qu’elles deviennent les premières universités. Entre temps, les centres d’étude fleurirent à droite et à gauche, et se spécialisèrent qui en médecine, qui en droit, qui en théologie. Les goliards apparaissent durant cette période. Groupe indéfini d’étudiants paillards, violents, mais maniant l’écrit en langage vernaculaire avec brio. Nous replongeons dans l’art par la parole, par l’écriture, par la chanson aussi. La chanson est aussi un acte magique. L’art et la magie, l’art et le culte sont trop intrinsèquement liés pour ne pas comprendre qu’ils sont imbriqués entre eux. Si les chercheurs ont pu déterminer que la magie provient du don (Marcel Mauss), il faut en conclure que le principe de l’art est le don.
Une fois l’université fondée, les goliards disparurent sans laisser de traces, progressivement, tandis qu’à la même époque étaient reconnus les étudiants de la bazoche. Ces étudiants de droit, ultime étape des universitaires, étaient déjà semi-professionnalisés, tout comme les internes de médecine de nos jours. Ils préservèrent et augmentèrent les écrits goliardiques, se montraient en d’impressionnants cortèges carnavalesques tels que les montres, la procession de l’arbre de mai, la fête des innocens, de l’asne, des sots …
Ils sont à l’origine de ce qui deviendra le théâtre moderne et de la comédie.
L’humour est toujours parti prenant dans leurs créations, comme la cause grasse, vrai procès mais traité avec humour et grivoiseries. Le royaume de la Bazoche vécu quatre siècles, et ne se rendit qu’avant le règne de la terreur. Au même moment, des collèges révolutionnaires naquirent, et s’inspirèrent des traditions bazochiennes. Napoléon 1er transforma l’ensemble des enseignements en écoles militaires, et les traditions s’en ressentirent dans leurs formes. L’aspect militaire est toujours d’actualité au sein des rites actuels, comme l’a si bien démontré Brigitte Larguèze.
Toutefois, il est remarquable de constater que malgré les teintes données par l’ensemble des siècles, le rite agraire est toujours palpable dans les traditions étudiantes, et Bacchus toujours célébré !
Cela ne correspond guère avec ce qu’en exposent les experts en sciences humaines spécialisés dans le bizutage. C’est qu’ils se sont limités à la création des écoles napoléoniennes pour asseoir leur travail, et si celui-ci est toujours de valeur, il est souvent faussé par cette mise en perspective tronquée.
Avant de se permettre d’analyser les rites actuels, il faudrait encore prendre en compte deux ou trois points essentiels.
D’abord, les gouvernements successifs d’Europe sont dans une logique matérialiste, et individualiste. Pour pouvoir s’enrichir au détriment des autres, il faut rationnaliser en masse. Quand les lignes de chiffres sont substituées aux humains, il ne paraît plus du tout inconvenant de laisser des gens mourir de froid, à Ouistreham, dans le pays des droits de l’homme. Pour éviter tout débordement, on casse le principe de solidarité. En légiférant sur des pratiques bizutantes, le gouvernement oblige les groupes à se réajuster, mais sans la connaissance préalable de ce que nous venons d’évoquer, ni pour les initiateurs, ni pour les établissements. Le rite vie/mort/vie est dénaturé, mais selon le principe de sympathie, même dénaturé il peut rester efficace, car d’une ossature peut renaître le corps entier. Toutefois, avant d’être ajusté au mieux, des erreurs peuvent être commises, des successeurs peuvent ne pas avoir assimilé la leçon donnée, ou la reproduire de travers. Telles sont, la plupart du temps, les drames liés au bizutage.
L’individualité étant poussée à l’extrême, nous parvenons à du « chacun pour soi », ce qui entraîne aussi les douleurs de l’égo qui refuse de se laisser porter pour le bien social. C’est ainsi qu’on en arrive au sophisme suivant : « la pression sociale des amis et futurs collègues pousse le novice à faire son bizutage, et le regrette ensuite ». Ce même principe de pression de groupe est à l’œuvre d’une façon bien plus vaste pour vous faire acheter des produits inutiles, et personne ne vient s’en plaindre.
Il faut du courage aux initiateurs des traditions pour braver les interdits. Identifier un besoin social, en lien avec les besoins d’appartenance, de réalisation de la pyramide de Maslow, pour lequel ils possèdent des rituels de soin symboliques mais éprouvés, et se trouvent face à l’interdiction de pratiquer. Le rite est avant toute chose un soin magique.
Non, les rites étudiants – y compris le bizutage – n’ont pas la volonté de faire du mal aux autrui sous le simple prétexte qu’ils peuvent le faire. L’accident n’est rien d’autre qu’un accident.
L’interdiction n’a jamais amené à rien d’autre qu’à la suspicion envers l’autre, tandis que l’accompagnement permet à chacun de valoriser le profitable de chacun. Et en terme de profitable, ne perdons pas de vue l’humour et l’art, ce qui fait toute la magie d’une période facultaire épanouie, ouverte à l’altérité aussi bien dans notre université qu’au national, et même pour les plus audacieux, à l’international. Période marginale de la société, où l’on fait des rencontres qui perdureront toute une vie.
L’analyse des rites actuels en Europe, berceau de l’ensemble des traditions étudiantes au niveau mondial, ne peut se faire qu’en se rendant sur les lieux, en déterminant ce qui est toujours pratiqué ailleurs comme à cet endroit, en établissant pourquoi ces endroits ont-ils préservé ces points précis du rite tandis que d’autres les ont réduits ou abandonnés, tout en en conservant d’autres. L’histoire de chaque lieu aidera à comprendre les incidents ayant produit ces divergences.
L’art est à peine esquissé au fil de ce qui précède. Pourtant, il apparaît tout du long comme un fil rouge. La pratique créatrice, magique par définition, est repérable dans la façon dont chacun travaille ses oripeaux, en les ajustant à sa propre personnalité. La coiffe étudiante est une sorte de temple portatif pour l’étudiant. C’est aussi un talisman le protégeant tout au long de son cursus. Il se charge en énergie magique, et doit se porter en tout temps et en tout lieu lié aux études. On ne se décoiffe devant personne hormis s’il a le rang de recteur (devenu entre-temps président d’université). Les oripeaux ont eux-mêmes du sens par ce qu’ils renvoient. C’est de la théâtralisation. Rien n’y est concret, tout y est symbolique par le biais de l’humour. Cet humour amené par les goliards au sein du théâtre et de la chanson, puis, par les bohèmes de Paris en plein romantisme. Les journaux satiriques sont autant de témoignages d’étudiants engagés, à commencer par Félicien Rops. Les étudiants en beaux-arts sont nombreux parmi les artistes incohérents. Ils aideront à monter les bals masqués pour ce mouvement, avant de le reprendre à leur compte une fois l’incohérence disparue.
Des incohérents émergeront de nombreux mouvements de l’histoire de l’art moderne et contemporain, pour les retrouver, suivez l’humour !