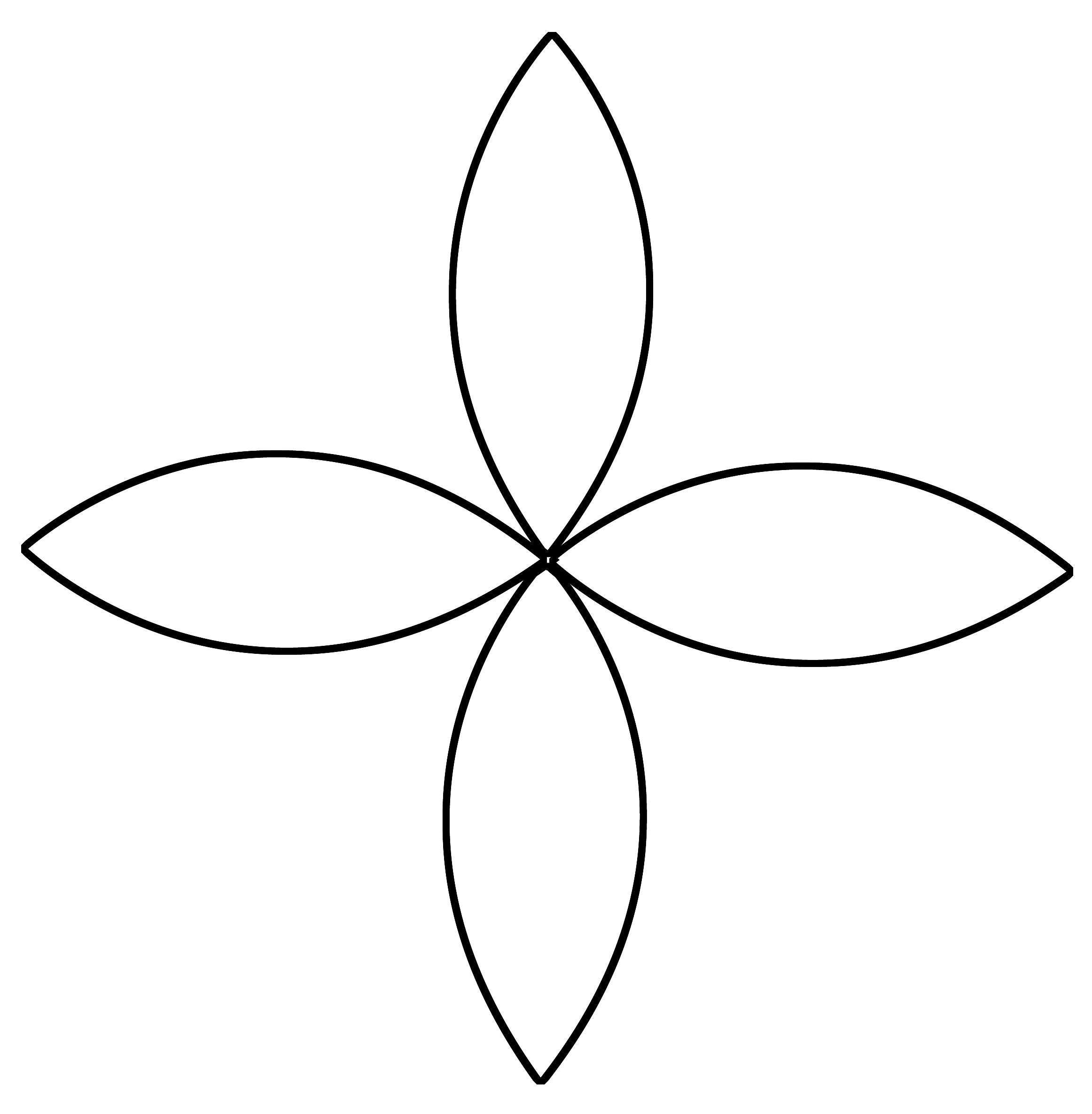La recherche : Rites étudiants - Délire ou Magie primitive?
Utilisation des sources
Du béjaune au bleu
Horizon des recherches existantes
Esthétique des rituels étudiants
Rites étudiants - Délire ou Magie primitive?
Esthétique de la souillure
En conclusion
Analyse du film "Praxis"
Nous ne sommes plus très loin de comprendre que les rites étudiants font référence à une sorte de religion ou de magie primitive.
Le docteur Cabanès a évoqué le lien entre les processions festives médiévales telles que la fête des sots, et les Bacchanales d’origine égyptienne, passées par la Grèce, puis par Rome. La thèse de l’auteur voulait corroborer ces pratiques aux cortèges de carnaval, mais il n’y a pas perçu l’origine des monômes d’étudiants. Et pourtant, les festivités médiévales étaient l’apanage des clercs, les processions des bazochiens pour l’arbre de mai et la Montre sont restées dans les mémoires.
Cabanès nous montre les bacchants comme des prêtres déguisés en silènes, pans et satyres tout au long du cortège. Longtemps, seuls les hommes y étaient admis, puis l’« élément féminin s’y introduisit ». Dès lors, ce fut le début d’orgies devenues mythiques, dans lesquelles les bacchantes, vêtues de peaux de panthères, de tigres et couronnées de lierre, brandissaient des thyrses (bâtons surmontés d’une pomme de pin et entortillés de pampres) et courraient de çà et là en lançant le cri «Evohe ! Evohe ! Bacche !». A la fin de la bruyante procession Bacchantes et Bacchants se rendaient au lieu sacrificiel, éventraient les outres de vin, hurlaient, s’exaltaient jusqu’au délire, et «se livraient à de telles folies, que le mot est resté pour caractériser les femmes folles de leur corps.»
Comparativement, l’esthétique comme le fonds, des cortèges suivis de banquets des instances universitaires ou des associations étudiantes, restent intégralement au sein de ce cadre, seule change l’intensité du phénomène. Arnold Van Gennep nous relate le baptême comme un passage spécial, et par sympathie, les baptêmes étudiants correspondent également à cette définition.
Nous le savons à présent, la chrétienté s’est appropriée la culture hellénique. C’est essentiellement dans les lieux liés à la connaissance que cela se produisit.
C’est à Alexandrie, lieu privilégié de la cohabitation religieuse dès la période hellénistique, que se produit la rencontre entre les mondes dionysiaques et chrétiens. Ne l’oublions pas, les auteurs chrétiens étaient «complètement insérés dans le contexte culturel gréco-romain et sa paideia», nous annonce Francesco Massa. Tout ce qu’ils produisaient dérivaient de la tradition précédente.
C’est ainsi que nous voyons une succession de connaissances intellectuelles s’appuyant tout du long sur les connaissances du passé, et nous menant directement en Égypte, le centre incontesté des savoirs, depuis la création de la plus importante des bibliothèques du monde antique.
Certains préservèrent les mystères, qui sous forme de théâtre, qui par des locutions à peine voilées, et peut-être même, les réimplantèrent sous un jour nouveau : le béjaunage.
« La déesse, disait-on à Éleusis, avait fait aux hommes deux dons : le blé, fondement de la vie civilisée, et les mystères, qui contenaient la promesse d’ « espérances meilleures » pour un au-delà heureux. Ces mystères étaient célébrés à Éleusis exclusivement et nulle part ailleurs.
Or, les mystères d’Éleusis étaient destinés au couple égyptien Isis et Osiris, qui par son mythe, fut assimilé à Dionysos.
Dionysos, le dieu du vin et de l’extase, était adoré partout, car tout buveur pouvait se regarder comme le serviteur du dieu. L’existence de mystères propres, d’initiations personnelles et secrètes, avec la promesse de la béatitude éternelle dans l’au-delà, a été récemment confirmée par la trouvaille sensationnelle de lamelles d’or dans des tombes : et, par exemple, une lamelle d’or provenant d’Hipponion, en Italie du Sud, mentionne les mystai et bakchoi cheminant aux enfers, sur la « voie sacrée », tandis que deux textes provenant de Thessalie parlent de la mort comme d’une « naissance » et d’une délivrance effectuée par Bakchios. » (W. Burkert, 1987)
Du point de vue des traditions, nombreux sont les inserts dionysiens. Ainsi, si nous nous en référons aux Carmina burana de Carl Orff, nous apercevons bien des bazochiens, ces clercs juristes, buvant dans la taverne, évoquant Bacchus.
Les habitudes des personnes fréquentant le lieu peuvent-elles servir de point de comparaison avec les pratiques actuelles ?
«In taberna quando sumus»
(Chœur)
In taberna quando sumus
non curamus quid sit humus,
sed ad ludum properamus,
cui semper insudamus
Quid agatur in taberna,
ubi nummus est pincerna,
hoc est opus ut queratur,
si quid loquar, audiatur.
Quidam ludunt, quidam bibunt,
quidam indiscrete vivunt.
Sed in ludo qui morantur,
ex his quidam denudantur
quidam ibi vestiuntur,
quidam saccis induuntur.
Ibi nullus timet mortem,
sed pro Baccho mittunt sortem.
.
Primo pro nummata vini,
ex hac bibunt libertini;
semel bibunt pro captivis,
post hec bibunt ter pro vivis,
quater pro Christianis cunctis
quinquies pro fidelibus defunctis,
sexies pro sororibus vanis,
septies pro militibus silvanis.
Octies pro fratribus perversis,
nonies pro monachis dispersis,
decies pro navigantibus
undecies pro discordaniibus,
duodecies pro penitentibus,
tredecies pro iter agentibus.
Tam pro papa quam pro rege
bibunt omnes sine lege.
Bibit hera, bibit herus,
bibit miles, bibit clerus,
bibit ille, bibit illa,
bibit servus cum ancilla,
bibit velox, bibit piger,
bibit albus, bibit niger,
bibit constans, bibit vagus,
bibit rudis, bibit magus.
Bibit pauper et egrotus,
bibit exul et ignotus,
bibit puer, bibit canus,
bibit presul et decanus,
bibit soror, bibit frater,
bibit anus, bibit mater,
bibit ista, bibit ille,
bibunt centum, bibunt mille.
Parum sexcente nummate
durant, cum immoderate
bibunt omnes sine meta.
Quamvis bibant mente leta,
sic nos rodunt omnes gentes
et sic erimus egentes.
Qui nos rodunt confundantur
et cum iustis non scribantur.
Pour l’étudiant belge et français, un insigne nommé « Bacchus » désigne la dignité dans l’ivresse, et cet insigne représente le portrait classique de Gambrinus à cheval sur son fut de bière. Le glissement d’une image à l’autre est déjà significatif en lui-même.
Ce qui nous est parvenu de Dionysos, quoique très lacunaire, est suffisant pour aborder le parallèle entre les mystères et les rites d’initiation des étudiants.
Tout d’abord, nous connaissons le mythe de ce fils de Zeus et de la mortelle Sémélé, décédée en lui donnant la vie. Comment le roi des dieux le plaça dans sa cuisse pour achever la gestation, comment il naquit une seconde fois en sortant de la cuisse de son père. Nous connaissons l’histoire de son démembrement et de sa résurrection, naissant ainsi une troisième fois après son séjour dans l’Hadès. Dès qu’un passage de vie/mort/vie s’opère dans un mythe, un conte, ou une histoire, nous pouvons le replacer dans la lignée des premiers rites agraires - où la plante meurt le temps d’un hiver et ressuscite ou renaît d’une graine. Dès lors, le chemin parcouru s’éclaire sur le mythème, le principe fondamental, en le replaçant sur le mythe d’Inanna.
Cette déesse épousa un mortel, et rejoignait sa sœur aux enfers tous les six mois, laissant son mari régner pendant cette période. Depuis l’époque sumérienne, le pouvoir féminin était reconnu et respecté.
Il fallut attendre le principe du Dieu unique et patriarcal pour observer un changement de mentalité. Dans un même temps, la Grèce antique reléguait les femmes hors du pouvoir politique. Dionysos, par le remembrement de son corps, symbolisé par un phallus d’or amené en procession, se montrait mort et espoir de vie. Il était à ce titre comparé à Osiris, remembré lui aussi par Isis.
Isis est une nature comparable à Inanna, Astarté, Ishtar... Le couple d’Isis et d’Osiris est à l’origine des rites d’Eleusis, si proches de Bacchus. Dionysos est donc bien un symbole de retour à la vie, tout d’abord physique, puis par l’orphisme, eschatologique - ce qui nous adviendra après avoir franchi le seuil de la mort. Dieu de l’ivresse, de la déraison, mais gardien du seuil entre l’homme sain et le fou, il est le dieu de la raison dans la déraison, de la mesure dans la démesure. En somme, il est l’exacte opposition à la rationalité, démontrant qu’une rationalité pure est contraire aux principes de la vie. Tout autant, la déraison ne peut être un principe régissant à long terme la société. Mais peu comprennent l’importance de la dualité rationnel/irrationnel, au quotidien.
Comme l’évoquais Platon : «Nombreux sont les porteurs de thyrse, et rares sont les Bacchants».
Le culte dionysiaque se pratique au départ dans les montagnes et les territoires marginaux, par de délirantes et violentes célébrations à l’usage de communautés éphémères de femmes.
J.J. Wunenburg précise en 2001 que «L’autorégulation par la violence et la levée des transgressions reste donc canalisée sur les confins».
Dionysos ne put entrer dans la ville d’Athènes qu’après s’être expurgé, théâtralisé. La théâtralité remplace les festivités violentes par une scénographie censée purger les passions.
Le dionysiaque comme racine du théâtre, selon Nietzsche, «n’a pu s’acculturer qu’au contact de la sublimation apollinienne». (J.J. Wunenburg, 2001).
Qu’y aurait-il donc de surprenant aussi, comme le démontre le serment des faluchards, à lier Dionysos aux écrits de ce médecin et homme de lettres qu’était François Rabelais, lui qui nous laissa tant de sources de la vie des étudiants ?
Panurge, dans l’œuvre de François Rabelais, ne se met-il pas en quête de l’oracle de la Dive bouteille, dont la parole vaut plus que celle des docteurs en théologie ?
Les cérémoniels étaient, au sein des mystères, réservés aux seuls initiés. Mais n’en est-il pas de même pour les soirées de corporations ou des porteurs de faluche ? Et partant de là, peut-on dégager du sens de ce propos, en questionnant des acteurs du monde estudiantin sur leurs traditions, et si celles-ci leur ont permis d’apprendre la mesure dans la démesure ?
Tout autant, la tradition rituelle étudiante se pratique dans des territoires marginaux – d’autant plus qu’avec la législation à propos des bizutages elle ne peut plus les circonscrire dans les écoles et organise donc des baptêmes, des W.E.I., au cœur de la nature. On chasse le bitard dans la forêt de Ligugé, et les Crit’s de pharmacie ou de médecine n’ont rien à envier dans leurs pratiques aux plus intenses des bacchanales. Les liens estudiantins avec le théâtre ne sont plus à démontrer, qu’il s’agisse de scénographie pour les bizutages ou du «Théâtre» en son sens le plus noble, les étudiants ont joué un rôle qu’on ne peut tenir pour anecdotique. En présidant aux rites étudiants, Dionysos canalise la violence de la jeunesse.
L’aspect cultuel, même, en tant que lien de socialité, est porteur de sens puisque M. Borbouse cite en 2015 : ««P. Dessez (2007, p83) souligne que nous vivons dans « une société où l’étoffe du sens et la consistance du lien social s’affaiblissent ». Ne s’agirait-il pas là d’éléments susceptibles d’expliquer la participation aux baptêmes ? »
La relégation des religions au rang d’«Opium du peuple» fut un pas en avant du sur-rationnel.
Le principe de libre examen étant bafoué par ses propres prédicateurs en en faisant glisser le sens vers un agnosticisme pur et simple, comme en témoigne depuis un siècle la tradition étudiante de l’Université Libre de Bruxelles. Il devient essentiel d’observer les mécanismes de «mise au placard» que subissent les subjectivités portées par les groupes sociaux à philosophie humaniste.
Le sur-rationnel est, à mon sens, le surplus de rationalité exercé sur un ensemble social au détriment de l’humanité. En dégageant tout sens moral lié aux cultes, on en vient à ne plus respecter la vie, à promouvoir l’aspect prométhéen, soit la démesure de la technique au détriment de l’individu.
Et tout autant, nous vivons une période où l’individualité excessive prend le pas sur le bienfondé sociétal. Qu’il s’agisse de finances, ou encore de l’égo, l’individu prime sur l’ensemble du groupe via les réseaux sociaux. Pour exemple, mais c’en est un parmi d’autres, le combat forcené des féministes d’aujourd’hui n’est plus tant de lutter pour que la féminité soit reconnue comme équivalente à la masculinité, que par une façon de s’approprier son propre corps, en passant par le dénigrement, la critique - comme si sa propre vie en dépendait, des valeurs du couple, des sociétés traditionnelles de type corporation étudiantes à la virilité exacerbée, de la masculinité dans tout ce qu’elle représente.
Elles sont les «néo-ménades», dont la violence non canalisée sert le jeu d’une optique capitaliste, voulant isoler l’individu pour mieux le manipuler, mieux le transformer en Humain 2.0 grâce aux usages scientifiques, pour lesquels l’éthique doit fermer les yeux au nom d’un prétendu bienfait pour une humanité, dont la seule utilité serait d’être consommatrice des produits dérivés de ces avancées.
Les réseaux immatériels d’internet sont un facteur aggravant d’isolement de l’humain. Ils permettent en outre une surveillance simplifiée des groupes, comme des individus, et de leur fournir par le biais de publicités ciblées, les gadgets coûteux à l’obsolescence programmée. Seuls les plus argentés peuvent s’offrir ces objets dont la technologie appauvrit la nature par la production de minerais rares, excessivement onéreux en termes écologiques.
Lorsqu’il fallut se choisir une devise nationale après la Révolution française, il est intéressant de se poser la question du mot égalité, préféré au mot solidarité, ou plus justement encore, équité. Le désir des révolutionnaires n’a jamais été désiré comme équitable, mais égalitaire. Or, que pouvait bien signifier l’égalité de l’époque, comparativement à ce que nous vivons de nos jours ? Nous sommes libres et égaux en droit, dit le premier article des droits de l’homme.
L’abolition des privilèges de Droit Divin remplacés par les privilèges de Droit Pécuniaire engendre une iniquité, tout d’abord, une inégalité face à la loi, ensuite.
Suivant cette logique de la recherche volontaire de l’isolement des individus, nous comprenons pourquoi les réseaux corporatifs étudiants sont à présent malmenés. Qu’il s’agisse des fresques des Internats de France, auxquelles certains artistes très célèbres ont prêté leur talents (Fujita, Doré, Toulouse-Lautrec, ou plus proche de nous Reiser), on dénonce un sexisme utile pour faire repeindre les murs en blanc :
sur-rationnel.
Les dénonciations et «chasses aux sorcières» que vivent les traditions initiatiques sont autant de marqueurs de la volonté de l’état français d’éradiquer, sans en avoir l’air, les associations étudiantes. Plutôt que d’effectuer, comme cela se passe dans d’autres pays, une vigilance facilitée par la mise à disposition de moyens, on interdit la pratique en se dédouanant par la formule : «Ils sont majoritairement majeurs, et ce qu’ils font en dehors de mon établissement est hors de ma compétence».
J’estime cette formule comme une négligence coupable des autorités académiques. C’est en effet leur rôle de soutenir les étudiants dans ce qu’ils ont de plus original face à la gangrène institutionnelle. Sous le principe de vouloir offrir à chacun ce qu’il estime être un droit, on ôte toute reconnaissance au «vivre ensemble» communautaire.
Pasolini écrivait en 1975 « Une bonne partie de l’antifascisme d’aujourd’hui, ou du moins ce qu’on appelle antifascisme, est soit naïf et stupide soit prétextuel et de mauvaise foi. En effet elle combat, ou fait semblant de combattre, un phénomène mort et enterré, archéologique qui ne peut plus faire peur à personne. C’est en sorte un antifascisme de tout confort et de tout repos. Je suis profondément convaincu que le vrai fascisme est ce que les sociologues ont trop gentiment nommé la société de consommation. ».
Ma recherche en immersion m’a appris à estimer l’approche initiatique au travers de rites de différents pays. Toutefois, il y a toujours chez l’un, chez l’autre, des points tendancieux, voire dangereux, qu’il serait prudent de canaliser.
Ces traditions persistent, malgré les lois et les interdits. Elles sont pourtant volontaires pour être au plus juste de la légalité et des valeurs humaines, mais les principes dont elles ont la charge sont plus importants à leurs yeux que toute approche légale ou contraignante.
Le vrai risque à ne pas entendre, ni prendre en compte ce qui est pour elles essentielles, serait de dénaturer au mieux un protocole rituel, déjà partiellement révisé – ce qui, sans comprendre les fondations du rite est déjà dommageable en terme de risques psychologiques – en le rendant toujours plus inefficace et vidé de toute justification.
En tentant de comprendre, dans une optique d’éradication de cette pratique, la violence inhérente aux traditions rituelles étudiantes, les sciences humaines ont débordé de leur cadre scientifique neutre en excluant ce qui ne rentrait pas dans leurs cases. C’est ce qui leur donne l’impossibilité de pouvoir conclure sur le sujet de ces initiations. Claude Rivière leur ôte la possibilité même d’être une initiation en ne leur reconnaissant aucun fondement cultuel. Marc Audebert y perçoit une complaisance à voir souffrir les nouveaux.
Si des chercheurs du passé étudiant ont pu, tels Fortunat Strowski, et avant lui le docteur Augustin Cabanès, établir un lien ferme avec les rites bachiques, les saturnales et les mystères d’Eleusis, il est surprenant de constater l’absence de toute trace de ces recherches au travers des sciences humaines tentant de définir les principes du bizutage. Le lien n’est pourtant pas difficile à suivre pour qui s’en donne les moyens. La comparaison avec les façons de vivre du passé intéresse pourtant bien la sociologie pour d’autres cas de figure, alors pourquoi cette piste ne fut-elle pas suivie ? Le principe de base, c’est une vue restreinte au simple objet de l’étude. Ainsi, on ne place pas en parallèle les traditions entre elles pour découvrir les ressemblances, for les cas où la violence visuelle peut étayer un propos négatif. En effet, il n’est pas rare que des images tournées en Belgique illustrent des propos de bizutages français.
Pourtant, rien qu’en prenant l’archétype de Dionysos, nous rencontrons les grandes lignes qui forment l’ensemble des traditions étudiantes actuelles, tant dans le fond, que dans l’esthétique.
Pour commencer, si le plus grand don de Dionysos est celui de l’émancipation, c’est bien un sentiment de totale liberté qu’éprouvent tous les étudiants quittant pour la première fois le giron familial. Mais comme tous les dons de Bacchus, il est dangereux s’il n’est pas maîtrisé. La liberté de se rendre ou non aux cours, entraîne un risque d’isolement individuel d’autant plus marqué si la personne est timide. Le rituel de première année (étendue à la seconde année pour ceux qui doivent au préalable passer un concours, comme pour les études de santé) est là dans une volonté de socialiser l’arrivant. Par des soirées, des jeux à boire, par une proximité forcée, les barrière de l’altérité s’estompent rapidement, et donnent à la promotion des outils pour travailler ensemble plus diligente.
Si à certaines époques, les transmissions se pratiquaient au sein même des écoles, c’est qu’on y donnait les bases pour supporter le futur métier, sous l’œil des anciens. Ce principe devenant caduc par les lois anti-bizutages restrictives, on chasse des enceintes des établissements éducatifs les traditions, comme l’on a jadis chassé d’Athènes Dionysos. Il entraina dans son sillage toutes les femmes de la ville, et parti s’établir dans les lieux marginaux que sont les montagnes, les forêts. Ainsi, l’archétype de Bacchus entre encore en corrélation avec les étudiants de l’université.
D’une part, Jacques Koot dans son «Io Vivat», nous retrace pourquoi la première université de Belgique ne fut pas fondée à Bruxelles - en raison d’un risque trop grand de viol des jeunes filles de la ville, mais bien à Malines, avant de s’installer définitivement à Louvain.
Ensuite, car les lieux de traditions se déroulent à présent hors de vue de toute autorité. Des établissements de boisson proposant une pièce privatisée aux initiations, des sociétés d’événementiels offrent des «Week-end d’intégration» clé sur porte, des lieux retirés en campagne sont les sites privilégiés pour transmettre les rites.
Les points communs que l’on peut établir entre l’aspect marginal des bacchantes reléguées dans les montagnes et les forêts, avec les lieux où se pratiquent les congrès étudiants, les bizutages, les week-ends d’intégration, entrent en résonnance également avec l’étude de Marcel Mauss, en 1902. Pour ce sociologue, les cérémonies magiques se pratiquent d’ordinaire dans les bois, à l’écart des habitations, dans l’ombre ou en pleine nuit, dans les recoins de la maison, puis, moins communément, dans les temples ou sur l’autel domestique. « Tandis que le rite religieux recherche en général le grand jour et le public, le rite magique le fuit. Même licite, il se cache, comme le maléfice. » La différence entre le culte et la pratique magique semble essentielle à produire pour mieux clarifier si les traditions étudiantes sont de la magie ou descendent d’une religion. La magie serait, selon lui, la première forme de la pensée humaine, existant à l’état pur. «…l’homme n’aurait même su penser, à l’origine, qu’en termes magiques. La prédominance des rites magiques dans les cultes primitifs et dans le folklore est, pense-t-on, une preuve grave à l’appui de cette hypothèse.» Mis en regard de la citation de Paul Valery annonçant que : «L’art est l’image de la pensée», nous pouvons d’ors et déjà envisager le fait que la magie et l’art sont apparus conjointement, l’un étant la manifestation de l’autre.
Si les mystères, dont les manifestations esthétiques se définissent comme une pratique magique, peuvent également être perçus comme de l’art, ils sont aussi essentiellement les germes des religions telles qu’on les pratique de nos jours. Toutefois, si l’importance humaine d’accéder aux mystères peut sembler être en lien avec l’acquisition de connaissances eschatologiques – et elle l’est, ce n’est pas pour autant qu’elle se résume à ce savoir. Ainsi, Walter Burkert précise «Le mot d’ordre des mystères n’est pas «secours» ou «salut», mais «béatitude», et en référence à l’au-delà plus qu’à n’importe quoi d’autre : l’«autre don» de Déméter, à côté de la production des céréales, est la promesse d’une vie privilégiée après le tombeau, pour ceux qui ont «vu» les mystères. »
Mais l’art mène également à la connaissance, et à la béatitude – tant de son auteur que des personnes qui contemplent son travail.
Ne dit-on pas d’un éminent praticien de quelque procédé que ce soit, qu’il est un artiste en sa matière ? « La magie constitue ainsi, à la fois, toute la vie mystique et toute la vie scientifique du primitif. Elle est le premier étage de l’évolution mentale que nous puissions supposer ou constater. » nous évoque Marcel Mauss, qui est on ne peut plus clair sur le lien entre la magie et la connaissance, et par conséquent l’enseignement.
Pour enseigner, il faut impérativement au moins une personne possédant le savoir et prête à le transmettre, et une autre réceptionnant cette transmission. L’art est magique car il fait partie d’un processus qui n’exige aucun apprentissage préalable, et se transmet par sympathie. C’est par le labeur que l’individu se perfectionnera, qu’il ait ou non un maître à disposition.
Le maître lui fera juste gagner du temps. C’est par l’art que naquit le sacré.
Mircéa Eliade précise : « C’est donc à cette science traditionnelle qu’obtiennent accès les novices. Ils sont longuement instruits par des tuteurs ; ils assistent à des cérémonies secrètes, subissent une série d’épreuves, et ce sont surtout celles-ci qui constituent l’expérience de l’initiation : la rencontre avec le sacré. La majorité des épreuves initiatiques impliquent, d’une façon plus ou moins transparente, une mort rituelle suivie d’une résurrection ou d’une nouvelle naissance. Le moment central de toute initiation est représenté par la cérémonie qui symbolise la mort du néophyte et son retour parmi les vivants. »
Pour Marcel Mauss, la magie se décompose en agents, en actes et en représentations. Celui qui pratique l’acte magique sera appelé magicien, qu’il soit ou non professionnel, tout comme sera artiste celui qui pratique l’art, qu’il soit professionnel ou non, également comme sera considéré bizuteur celui qui bizute, qu’il fut ou non bizuté.
«…nous appelons représentations magiques les idées et les croyances qui correspondent aux actes magiques ; quand aux actes, par rapport auxquels nous définissons les autres éléments de la magie, nous les appelons rites magiques.»
Mauss évoque aussi le lien entre la tradition et les rites magiques. Selon son point de vue, tout « rite magique, et la magie tout entière sont, en premier lieu, des faits de tradition. » C’est parce que les actes se répètent qu’ils sont magiques. «Des actes à l’efficacité desquels tout un groupe ne croit pas, ne sont pas magiques. La forme des rites est éminemment transmissible et elle est sanctionnée par l’opinion. D’où il suit que des actes strictement individuels, comme les pratiques superstitieuses particulières des joueurs, ne peuvent être appelés magiques. » L’art pariétal s’est étendu sur un vaste territoire, durant une très longue période de gestation. C’est que la tradition, à une époque où la communication était très lente, pris son temps pour se rependre.
Le mystère entourant ces œuvres peintes au plus profond des entrailles terrestres n’est pas sans lien avec ce que Clarissa Pinkola Estés nomme le principe de vie-mort-vie. L’être vivant plonge sous la terre, le royaume des morts, et en revient sous une forme augmentée. Le magicien est capable de pratiquer son art seul, mais dans certains cas, c’est l’ensemble des individus l’entourant qui doivent lui prêter assistance pour valoriser la portée de l’acte. La forme esthétique prise dans ces instants-là, peut se percevoir pour la personne étrangère à cette culture, comme une forme de « Happening », ou de théâtre. « L’étrangeté et la bizarrerie des rites manuels correspondent aux énigmes et aux balbutiements des rites oraux. Loin d’être une simple expression de l’émotion individuelle, la magie contraint à chaque instant les gestes et les locutions. Tout y est fixé et très exactement déterminé. » disait Marcel Mauss.
Nous le voyons, le rite magique descend de la tradition, et non l’inverse, et la tradition n’est qu’une réactualisation à forte teneur morale et esthétique de l’art primordial. Or, la tradition possède une fonction. Elle n’œuvre pas dans un but de reproduction des actes humains précédents, ni n’a l’ambition de parfaire ceux-ci. Au contraire, c’est la commémoration de ce qui s’est produit dans le temps d’avant le temps, l’actualisation du «Temps mythique».
Paul Valery nous disait : « La véritable tradition n’est pas de refaire ce que les autres ont fait mais de trouver l’esprit qui a fait ces grandes choses et qui en ferait de toutes autres en d’autres temps. ». N’est-ce pas également la vocation de l’artiste ?
Dans la pratique, les rites étudiants sont souvent mal perçus par les regards extérieurs. C’est que l’aspect, esthétiquement rude, mis en œuvre par les traditions a de quoi choquer : souillures, rabaissement statutaire systématique du novice, jeux connotés sexuellement, esthétique de violence. Pour chacun de ces points il existe une explication prouvant que l’on se situe au niveau symbolique et non pratique.
Toutefois, il y a quelquefois des risques d’incident par manque de compréhension. Les meneurs n’étant pas assez, ou mal, formés, ne parviennent pas à maîtriser la situation que ces rites engendrent, autant du côté du novice, que pour le meneur. C’est dans ces cas précis que sont censés intervenir les anciens, afin de reprendre le contrôle. Si cette étape ne fonctionne pas, le risque de dérapage dramatique est bien réel.
Les sciences humaines ont bien défriché les risques encourus, il est donc inutile de s’y appesantir. Il suffit de savoir qu’ils peuvent être de nature physique comme des scarifications, des brûlures, ou psychologiques par détachement de soi au moment des faits, et non acceptation de nos actes après coup. Chacune de ces pratiques relève du droit pénal, tout d’abord comme faits de bizutage depuis 2017, mais encore, pour chacun de ces actes, comme faits de violence.
L’aspect dionysiaque est ici révélé dans toute sa partie dangereuse, mais pour autant nécessaire à la compréhension rituelle. Un rite qui ne place pas en danger de façon opérative sera de moindre valeur au niveau de sa qualité d’apprentissage. Les jeunes gens acceptant le rituel doivent le faire en pleine conscience des risques encourus, qu’ils soient meneurs ou novices.
Les apports bénéfiques liés au passage des épreuves permettent au novice de s’intégrer au sein d’un réseau pré professionnel, incluant d’une part son année de promotion, mais les promotions supérieures également au sein de son établissement. A cela s’ajoutent les contacts avec les autres corporations à orientation équivalentes ou non, au niveau national, et pour les plus impliqués, au niveau international même. Comme une enquête sociologique effectuée en une faculté de médecine française nous apportait le témoignage suivant d’un étudiant de 4ème année : « … passer ce week-end de bienvenue, d’initiation, d’intégration, heu, on voit derrière, euh, beaucoup plus de, entre les étudiants beaucoup plus de, comment l’expliquer, de…, sentiments de groupe, d’appartenance, vraiment. Et, tout est fait dans la bonne humeur et dans les bonnes traditions, voilà, c’est un respect des traditions aussi je pense, qui travaille là-dessus. »
C’est pourquoi nous pouvons sans problème rejeter les conclusions de ces journalistes en mal de sensation, prenant appui sur leur propre conviction pour étayer une pratique mal comprise :
« La sexualité est dévoyée, les violences frappent le corps et révèlent ses faiblesses. » (E. Davidenkoff et P. Junghans, 1993)
Les liens à Vénus, mais surtout aussi dionysiaque sont évidents au cœur des traditions étudiantes. Apprendre au cœur d’un groupe, à ne pas juger de la sexualité de l’autre, tout en pouvant marquer ses propres limites. Le mot clé des traditions, c’est que chacun fait ce qu’il a envie, sans forcer l’autre.
Chez Bacchus, la femme est – ou n’est pas – maîtresse d’elle-même, mais n’a pas besoin du concours des hommes pour vivre sa vie. La femme y est puissante, incontrôlable, guidée par ses pulsions de chasseresse, y compris en terme de sexualité. Telles sont les ménades, telles apparaissent les femmes en traditions étudiantes. Mais, placé dans la marge, la, ou le novice, y est intouchable avant d’avoir franchi le seuil. Le viol n’a pas cours, et vaudrait à son auteur le bannissement pur et simple du groupe, plus les conséquences légales d’un tel acte.
Ainsi nous dit Michel Maffesoli : « Sous l’empire de Dionysos, on « s’éclate » rituellement et mutuellement pour le plus grand bien de la société en son ensemble. »
Témoin n° 1 – 4° année de médecine : « C’est vraiment, en fait, tout est vraiment fraternel. C’est un, c’est le seul système de tradition qui fait que les étudiants ont envie de le faire. Si on le faisait pas pour eux, il y a plein de gens qui se, s’en voudraient de, qu’on ne le fasse pas, voilà. Et à côté de ça, du coup nous après le rallye, c’est tous dans une soirée, on s’amuse tous, euh, pendant que les deuxièmes années, euh, donc les, ceux qu’on appelle, les étudiants qui viennent d’arriver, passent eux la nuit dans une tente, où ils dorment, et cetera, et euh, (rire dans la voix) des fois il fait un peu froid, c’est marrant. C’est marrant pour eux, (rires dans la voix) c’est marrant pour nous, euh, si ils ont envie de rentrer chez eux, ils peuvent, hein ? On n’interdit personne, mais c’est très marrant, donc voilà. C’est, c’est très, très bon enfant »
L’aspect dionysiaque, nous l’avons vu, se pratique dans les marges. Pratiquer un week-end étudiant – qu’il s’agisse d’un WEI, d’un congrès de la faluche, d’un baptême, … le lieu sera reculé, en extérieur ou en intérieur selon les coutumes (arrière bar, cave, …) ou les possibilités. Dormir « à la dure » sous une tente y est une pratique courante. Ce qui se passe sous les tentes est à discrétion du propriétaire de la tente, que ce soit dormir seul(e), en couple stable, avec un, une, ou plusieurs partenaire(s) de passage, ou accueillir chacun pour un « after » en offrant des produits de chez soi.
La contrainte des rites pousse le nouveau dans ses retranchements de confort. Possède-t-il au fond de lui la force d’âme nécessaire à rejoindre les plus anciens, ceux qui ont déjà produit leur preuve ? Le soutien de l’ensemble du groupe comprenant les meneurs et l’ensemble des novices est essentiel pour « oser ».
Car ce n’est rien d’autre que cela, en somme. Lorsque l’on étudie la médecine, « oser » découper un cadavre au scalpel, piquer un être vivant pour lui injecter un produit dont on a nous-même décidé de la quantité et prendre le risque de s’être trompé.
« Oser » c’est un des points essentiels qui rapproche les gens d’une même profession. Le rite produit une sympathie au sein du groupe, et si l’un peut le faire, pourquoi pas l’autre ? C’est d’ailleurs exigé dans la plupart des traditions que de pouvoir faire soi-même ce que l’on impose aux autrui.
Témoin n° 1 – 4° année de médecine : « Et ça nous a permis de nous euh, de nous rencontrer, ça nous a permis euh, de passer des bons moments ensemble, et on, quand on, quand on y repense aujourd’hui, c’était sympa donc ces moment-là, c’est des moments de dégustation euh, de choses peu reluisantes, d’insectes ou quoi que ce soit, après c’était des choses euh, pas très sympa euh, héhé, mais qu’on, qu’on acceptait et qu’on trouvait ça très très marrants, hein ? Ça nous dérangeait pas mais, … »
Marcel Mauss ajoute : « Les pratiques magiques ne sont pas vides de sens. Elles correspondent à des représentations, souvent fort riches, qui constituent le troisième élément de la magie. Nous avons vu que tout rite est une espèce de langage. C’est donc qu’il traduit une idée. »
Comme le dit notre premier témoin, «Ça ne nous dérangeait pas mais, ...». Ce « mais » qui peut signifier tellement de choses. Il est la marque probante du fait d’avoir franchi ses propres limites de confort. Cela indique aussi le trouble de l’indifférenciation systématique dans laquelle se retrouve le novice. En lui ôtant son nom, en l’affublant d’un sobriquet, on tue symboliquement l’ego pour le faire renaître plus loin. C’est autant la preuve du soutien par la pression du groupe.
Créer de toute pièce une tradition doit se faire en prenant en compte ces impératifs. Il n’est pas question de céder à la culture ambiante qui détruira tout ferment initiatique en les remplaçant par des jeux d’intérêt collectif. L’artiste commandant RoSWeLL tente au contraire d’y inclure au maximum ce qui fait sens, tout en poussant la réflexion à réduire les risques physiques et psychologiques au maximum.
« Lorsque nous voyons la magie attachée à l’exercice de certaines professions, comme celle de médecin, de barbier, de forgeron, de berger, d’acteur, de fossoyeur, il n’est plus douteux que les pouvoirs magiques sont attribués non pas à des individus, mais à des corporations. Tous les médecins, tous les bergers, tous les forgerons sont, au moins virtuellement, des magiciens. Les médecins, parce que leur art est mêlé de magie et, en tout cas, trop technique pour ne pas paraître occulte et merveilleux. » conclut Mauss.
Si l’on accepte le principe que les traditions étudiantes proviennent de la magie des cultes à mystère, à vocation agraire, de l’Antiquité, nous pouvons conclure que le principe vie/mort/vie est le point de départ.
Ce principe dirige vers une optique de guérison, ou d’acceptation de laisser partir lorsque l’on n’y peut plus rien. Bacchus nous évoque aussi d’apprendre à jouer avec les limites, sans les franchir.
Si l’on en croit Walter Burkert : «Le mot d’ordre des mystères n’est pas «secours» ou «salut», mais «béatitude», et en référence à l’au-delà plus qu’à n’importe quoi d’autre : l’« autre don » de Déméter, à côté de la production des céréales, est la promesse d’une vie privilégiée après le tombeau, pour ceux qui ont «vu» les mystères. »
Nous comprenons dès lors le principe opérant des rites d’initiation des étudiants, guérissant l’être morcelé – le novice – en agissant sur lui par l’apposition d’onguents (souillures), par la médication (ingurgitations diverses), en lui faisant prendre l’air par des sorties en ville.
Ainsi, J.J. Wunenburger écrira : « Mais pour J. Hillmann ce processus initiatique, lié à Dionysos, de reconstruction de ce qui est morcelé dans le Moi, reste chargé de dangers, car il occasionne de fortes décharges émotionnelles, aux antipodes de la sérénité des processus cognitifs. Comme en témoigne le mythe grec, chez Dionysos, la fusion-confusion des polarités s’opère de manière brutale, imprévisible, par des mouvements de va-et-vient, qui en font un être multiple et instable. Ensuite la transgression doit être payée au prix d’un châtiment, la mort, même si elle ne fait que préluder une immortalité. »
Le principe d’embrasser le crâne d’un animal mort est celui d’une vanité. Le principe « mort » du vie/mort/vie indispensable à toute initiation symbolique.
Témoin n° 1 – 4° année de médecine : « Ah - la tête, la tête de porc, et cetera. C’est des, c’est des choses, on peut, ceux qui le veulent peuvent, peuvent embrasser une tête de porc, c’est, ça a toujours existé, c’est une tradition qui existe, euh, ancestrale. Ceux qui ont envie de le faire, le font, ceux qui n’ont pas envie de le faire ne le font pas, c’est euh, marrant, euh, voilà, c’est des… C’est dans, dans ce style-là. Donc, euh, bon, voilà. »
Cela n’est pas tant le fait qu’il s’agisse d’un animal qui importe, mais celui de quitter la mort en l’embrassant comme pour un « au revoir », initiant volontairement son retour à la vie. Bien entendu, l’aspect animalier du crâne joue aussi, en second plan, sur la psyché. Elle permet d’approcher la bestialité, d’accepter sa nature instinctive sauvage.
En prenant en compte tout cet aspect de guérison du novice, morcelé de quitter le confort du domicile parental, il est difficile de donner quelque crédit que ce soit aux extrémistes de l’anti-bizutage. Le psychiatre Samuel Lepastier qui formule : « En fin de compte, on peut se demander si le bizutage n’est pas plutôt une manifestation de la tendance antisociale correspondant à ce moment délicat décrit par Erikson, où l’adolescent, à la recherche de son identité, peut être fasciné par les idéologies totalitaires. » se trompe et nous trompe.
Le principe de soumission à l’autorité est souvent mis en avant pour dénoncer les abus des rites étudiants. Mais de quoi parle-t-on ?
Audebert émet « l’hypothèse de la satisfaction liée à l’accomplissement de l’exercice de la souffrance sur des autrui»
Tout comme pour S. Lepastier, l’hypothèse ne peut tenir la comparaison face à l’optique de guérison des autrui. En outre, si l’on considère que la magie est un art, et que nous prenons en compte les phénomènes d’art thérapie comme probants, nous constatons que tout ce qui apparaît, à quelque niveau que ce soit au cœur des rites étudiants est orienté vers la guérison. De ces traditions en provenance de l’art et pratiquant la magie sont sortis les principes artistiques du théâtre et de la comédie. Se sont ébauchés par les arts plastiques et l’humour les bohèmes du XIXème siècle, les arts incohérents, Dada, et jusqu’à l’art contemporain qui en découle.
Marcel Mauss nous le démontre quand il dit :« Nous dirons volontiers que tout acte magique est représenté comme ayant pour effet soit de mettre des êtres vivants ou des choses dans un état tel que certains gestes, accidents ou phénomènes, doivent s’ensuivre infailliblement, soit de les faire sortir d’un état nuisible. Les actes diffèrent entre eux selon l’état initial, les circonstances qui déterminent le sens du changement, et les fins spéciales qui leur sont assignées, mais ils se ressemblent en ce qu’ils ont pour effet immédiat et essentiel de modifier un état donné. »
L’humour, la dérision, sont l’apanage des étudiants. Ne dit-on pas «blague de potaches » ? Dionysos préside au théâtre et à la comédie, nous le savons déjà. Mais il est aussi le patron de l’ivresse – qui comme chacun sait peut être joyeuse ou triste. La nature duale de Bacchus reparaît encore à nous. L’humour, la dérision, la déraison sont autant de propriétés des rites étudiants qui se révèlent dans l’ivresse.
F. Massa soutient : « sans Dionysos et ses traditions, le vin des chrétiens aurait probablement assumé des formes et des significations en partie différentes. » Ainsi, Dionysos a pu approcher le culte chrétien en y apportant une pointe de paganisme, de magie, de gestuelle et de decorum. A plusieurs niveaux, nous percevons encore de nos jours dans les chansons d’étudiants à l’esthétique gaillarde, de nombreuses références à la religion gréco-romaine, et notamment à Bacchus :
« Dans l’Olympe, séjour des Dieux
On boit, on patine des fesses,
Et le nectar délicieux
N’est que le foutre des déesses
Si j’y vais, jamais Apollon
Ne charmera plus mon oreille ;
De Vénus je saisis le con,
De Bacchus je prends la bouteille ! »
L’humour, et la perte d’esprit permanente comme la folie, ou provisoire comme l’ivresse ou la transe, rapprochaient des dieux. La dualité de Dionysos étant d’autant plus marquée par les rites d’inversion comme les « fêtes des innocens » organisées par les clercs.
Mais la magie procède aussi à certaines professions dispensées par les universités. Toutes celles nécessitant des mots et une gestuelle précises, qui lient et obligent à des formes solennelles. Marcel Mauss ne dit pas autre chose : «Dans la mesure où ils ont une efficacité particulière, où ils font plus que d’établir des relations contractuelles entre des êtres, ils ne sont pas juridiques, mais magiques ou religieux. Les actes rituels, au contraire, sont, par essence, capables de produire autre chose que des conventions ; ils sont éminemment efficaces ; ils sont créateurs ; ils font. Les rites magiques sont même plus particulièrement conçus comme tels. »
Et si la magie procède de l’art, alors nous ne pouvons qu’approuver cette phrase de Nicolas Bourriaud « Le point commun existant entre tous les objets que l’on classe sous l’appellation « œuvre d’art » réside dans leur faculté à produire le sens de l’existence humaine (d’indiquer les trajectoires possibles) au sein de ce chaos qu’est la réalité.»
Notes :
«Boudée par le Second Empire, elle finit par s’imposer sous la IIIème République. On observe toutefois encore quelques résistances, y compris chez les partisans de la République : la solidarité est parfois préférée à l’égalité qui implique un nivellement social et la connotation chrétienne de la fraternité ne fait pas l’unanimité.» http://www.elysee.fr/la-presidence/liberte-egalite-fraternite/
«La mise en œuvre d’une contrainte sur les bizuts, exercée par les épreuves qui leur sont destinées, comporte l’expression d’un rabaissement statutaire systématique produisant leur disqualification en tant qu’individus.» (Marc Audebert, 2013)
Quand nous sommes dans la taverne,
que nous importe de n’être que poussière,
mais nous nous hâtons pour les jeux,
qui nous mettent toujours en sueur
Ce qui se passe dans la taverne,
où l’argent est le roi,
ça vaut le coup de demander,
et d’écouter ce que je dis.
Certains jouent, certains boivent,
d’autres vivent sans pudeur.
De ceux qui jouent,
certains se retrouvent nus,
certains sont rhabillés,
d’autres sont mis en sac.
Personne ici ne craint la mort,
mais ils misent le sort pour Bacchus
Le premier est pour la tournée
puis les affranchis boivent,
une autre fois pour les prisonniers,
une troisième pour les vivants,
une quatrième pour les Chrétiens,
une cinquième pour les fidèles défunts,
une sixième pour les sœurs légères,
une septième pour la troupe en campagne.
Une huitième pour les frères pervertis,
une neuvième pour les moines dispersés,
une dixième pour ceux qui naviguent,
une onzième pour les plaideurs,
une douzième pour les pénitents,
une treizième pour les voyageurs.
une pour le Pape et une pour le Roi,
tous boivent sans loi.
La patronne boit, le patron boit,
le soldat boit, le prêtre boit,
celui-ci boit, celle-ci boit,
l’esclave boit avec la servante,
l’agile boit, le paresseux boit,
le blanc boit, le noir boit,
le pondéré boit, l’inconstant boit,
le fou boit, le sage boit,
Le pauvre et le malade boivent,
l’exilé et l’étranger boivent,
l’enfant boit, le vieux boit,
l’évêque et le doyen boivent,
la sœur boit, le frère boit,
la vieille boit, la mère boit,
celui-ci boit, celui-là boit,
cent boivent, mille boivent.
Six cent pièces filent
vite, quand, sans retenue,
tous boivent sans fin.
Mais ils boivent l’esprit gai,
ainsi nous sommes ceux que tous méprisent,
et ainsi nous sommes sans le sou.
Ceux qui nous critiquent iront au diable
et avec les justes ne seront pas comptés.